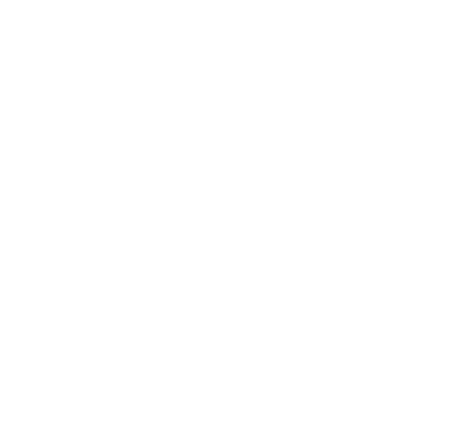


ORGUES DE PARIS © 2026 Vincent Hildebrandt ACCUEIL LES ORGUES

Les facteurs du 21e
siècle
Aubertin Blumenröder Cattiaux Chevron Cogez Dargassies Fossaert Grenzing Lacorre Muhleisen Plet Quoirin Rieger Autres
La facture d’orgues au 21e siècle :
un développement fécond !
Dans les dernières décennies du XXe siècle, ont redécouvrit la facture d’orgues du XIXème siècle qui fut, pendant un certain temps largement décriée. A l’aube du XXIème siècle, l’orgue symphonique du 19e siècle fut ainsi remis à l’honneur, donnant naissance à une politique de restauration plus scrupuleuse, respectant ainsi la Charte de Venise (1964). Ces dernières années, les travaux effectués sur les orgues parisiens peuvent êtres ainsi résumés en quatre grandes classifications : • Les restaurations visant à revenir à l’état d’origine ou un état antérieur (plus ou moins proche de l’instrument d’origine) Ces restaurations s’inscrivent dans la politique de conservation du patrimoine et dans le respect de la Charte de Venise. Qu’il soit permis ici de citer les restaurations exemplaires des orgues de Bécon les Bruyères (2015). • Les restaurations avec modifications et/ou agrandissements La nature de ces travaux permet d’embellir les instruments existants et parfois de corriger leurs défauts tout en respectant la facture présente et l’héritage du passé. On peut citer les travaux effectués sur les orgues de Notre-Dame D’Auteuil (2018) et les Grandes-Orgues de Notre Dame de Paris (2014) et de la Basilique Ste Clotilde (2005). • La création d’orgues neufs Bien qu’étant rares en ce début du XXIème siécle, la capitale a pu s’équiper d’instruments neufs souvent financés par des fonds privés, parmis lesquels on peut citer l’orgue Aubertin à l’église St Louis-en-l’ile (2004), l’orgue Rieger à la Philharmonie (2016, l’orgue Grenzing à l’auditorium of Radio France (2016) et l’orgue Chevron de la Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement (2017). • Les entretiens et relevages Ces derniers sont les plus courants du fait de la pollution et de l’utilisation souvent intensive des orgues de la Capitale. Cependant, l’entretien et la restauration des orgues parisiens existants est gravement entravée en raison d’un manque de fonds ; la plupart des restaurations en cette ère sont financées par des fonds privés (par exemple Sainte Clotilde, 2006). De nombreux concerts d’orgues et auditions témoignent de l’engouement des auditeurs concernant la musique d’orgue. Depuis 2009, se tient chaque année un festival des orgues de Paris. A l'occasion d'une série inédite de concerts d’orgue, ce festival entend incarner une idée simple : l'Orgue est un instrument résolument moderne ! De nombreuses paroisses proposent tout au long de l’année, parfois hebdomadairement ou mensuellement des concerts d’orgues ( Auditions du 2ème samedi du mois à la Basilique Ste Clotilde, Auditions hebdomadaires du samedi à Notre Dame, Audition dominicale à l’issue de la messe dominicale à St Sulpice) qui permettent de fidéliser un public mélomane et passionné. Parallèlement à l’activité culturelle de l’orgue, l’orgue continue à servir la liturgie. Si dans nombre de paroisses parisiennes la liturgie s’est considérablement dégradée avec l’arrivée du Concile Vatican II, un certain nombre de grandes paroisses comme la Basilique Ste Clotilde, St Séverin, La Madeleine essaient de rester fidèle à la belle musique et la liturgie digne. Un certain nombre de paroisses célébrants sous la forme du rite extraordinaire préservent le grégorien avec justesse (Ste Cécile, St Roch, St Nicolas du Chardonnet).Les facteurs du 21e siècle


Ce tableau recence l’activité des principaux facteurs d’orgues du 21ème siècle
(et des dernières décennies du XXe siècle) ainsi que le nombre d’orgues qu’ils
ont construit, restauré et/ou rénové. Ce tableau montre alors la prédominance
du facteur Dargassies, en particulier dans les dernières décennies du XXe siècle.
En ce début du troisième millénaire, on peut constater une forte baisse de
création d’instruments neufs par rapport du 19ème et 20ème siècle à cause du
manque de financement ainsi que la baisse de la pratique religieuse et un «
marché » bien saturé après des siècles de manufacture d’orgues à Paris.
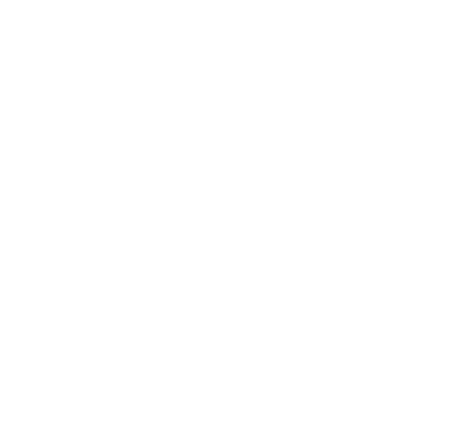
Les orgues de Paris
ORGUES DE PARIS © 2026 Vincent Hildebrandt LES ORGUES 


La facture d’orgues au 21e siècle :
un développement fécond !
Dans les dernières décennies du XXe siècle, ont redécouvrit la facture d’orgues du XIXème siècle qui fut, pendant un certain temps largement décriée. A l’aube du XXIème siècle, l’orgue symphonique du 19e siècle fut ainsi remis à l’honneur, donnant naissance à une politique de restauration plus scrupuleuse, respectant ainsi la Charte de Venise (1964). Ces dernières années, les travaux effectués sur les orgues parisiens peuvent êtres ainsi résumés en quatre grandes classifications : • Les restaurations visant à revenir à l’état d’origine ou un état antérieur (plus ou moins proche de l’instrument d’origine) Ces restaurations s’inscrivent dans la politique de conservation du patrimoine et dans le respect de la Charte de Venise. Qu’il soit permis ici de citer les restaurations exemplaires des orgues de Bécon les Bruyères (2015). • Les restaurations avec modifications et/ou agrandissements La nature de ces travaux permet d’embellir les instruments existants et parfois de corriger leurs défauts tout en respectant la facture présente et l’héritage du passé. On peut citer les travaux effectués sur les orgues de Notre-Dame D’Auteuil (2018) et les Grandes-Orgues de Notre Dame de Paris (2014) et de la Basilique Ste Clotilde (2005). • La création d’orgues neufs Bien qu’étant rares en ce début du XXIème siécle, la capitale a pu s’équiper d’instruments neufs souvent financés par des fonds privés, parmis lesquels on peut citer l’orgue Aubertin à l’église St Louis-en-l’ile (2004), l’orgue Rieger à la Philharmonie (2016, l’orgue Grenzing à l’auditorium of Radio France (2016) et l’orgue Chevron de la Chapelle Notre-Dame du Saint Sacrement (2017). • Les entretiens et relevages Ces derniers sont les plus courants du fait de la pollution et de l’utilisation souvent intensive des orgues de la Capitale. Cependant, l’entretien et la restauration des orgues parisiens existants est gravement entravée en raison d’un manque de fonds ; la plupart des restaurations en cette ère sont financées par des fonds privés (par exemple Sainte Clotilde, 2006). De nombreux concerts d’orgues et auditions témoignent de l’engouement des auditeurs concernant la musique d’orgue. Depuis 2009, se tient chaque année un festival des orgues de Paris. A l'occasion d'une série inédite de concerts d’orgue, ce festival entend incarner une idée simple : l'Orgue est un instrument résolument moderne ! De nombreuses paroisses proposent tout au long de l’année, parfois hebdomadairement ou mensuellement des concerts d’orgues ( Auditions du 2ème samedi du mois à la Basilique Ste Clotilde, Auditions hebdomadaires du samedi à Notre Dame, Audition dominicale à l’issue de la messe dominicale à St Sulpice) qui permettent de fidéliser un public mélomane et passionné. Parallèlement à l’activité culturelle de l’orgue, l’orgue continue à servir la liturgie. Si dans nombre de paroisses parisiennes la liturgie s’est considérablement dégradée avec l’arrivée du Concile Vatican II, un certain nombre de grandes paroisses comme la Basilique Ste Clotilde, St Séverin, La Madeleine essaient de rester fidèle à la belle musique et la liturgie digne. Un certain nombre de paroisses célébrants sous la forme du rite extraordinaire préservent le grégorien avec justesse (Ste Cécile, St Roch, St Nicolas du Chardonnet).Les facteurs du 21e siècle
Ce tableau recence l’activité des principaux facteurs
d’orgues du 21ème siècle (et des dernières décennies du
XXe siècle) ainsi que le nombre d’orgues qu’ils ont
construit, restauré et/ou rénové. Ce tableau montre alors
la prédominance du facteur Dargassies, en particulier
dans les dernières décennies du XXe siècle.
En ce début du troisième millénaire, on peut constater une
forte baisse de création d’instruments neufs par rapport
du 19ème et 20ème siècle à cause du manque de
financement ainsi que la baisse de la pratique religieuse et
un « marché » bien saturé après des siècles de
manufacture d’orgues à Paris.






















